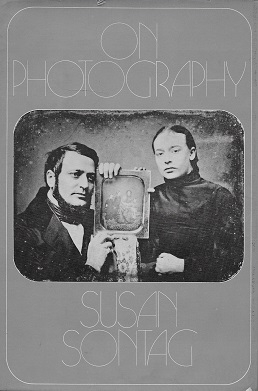Dès sa parution l’an dernier, Betty (traduit de l’américain par François Happe), le roman de Tiffany McDaniel dédié à sa mère, Betty Carpenter, a récolté un succès international. Le poème de Betty au début ne laisse pas de doute sur les malheurs qui ont accablé son enfance.
MA MAISON DETRUITE
Donne-moi un mur,
Je te donnerai un trou.
Donne-moi une fenêtre,
Je te donnerai une vitre brisée.
Donne-moi de l’eau,
Je te donnerai du sang.

© Tiffany McDaniel, Three Sisters, squash, corn, and beans, original painting by Tiffany
Betty est la sixième des huit enfants d’un père cherokee aux cheveux noirs, Landon Carpenter, et d’une mère plus jeune que lui de onze ans, Alka Lark, aux cheveux blonds. De tous ses frères et sœurs, c’est elle qui ressemble le plus à son père. Elle est sa « Petite Indienne », sa favorite, bien que cet homme « fait pour être père » soit attentif et attaché à chacun de ses enfants.
L’histoire dramatique de ce couple qui s’est marié en 1938 dans la désapprobation générale est racontée avec force par la romancière américaine : rejet de la famille Lark, difficultés rencontrées par Landon à son travail, quand il en trouve, déménagements nécessaires pour fuir la violence. Mais ce qui éclaire le récit du début à la fin, malgré toutes les horreurs qui s’y succèdent, c’est leur façon de vivre quotidienne en relation avec la nature.
Les arbres et les plantes, le soleil et les orages, les étoiles, tout ce qui vit autour d’eux vit avec eux. Le père de Betty lui rappelle comment, chez ses ancêtres, les Aniwodi, un clan de créateurs « réputé pour ses guérisseurs et ses sorciers », les femmes possédaient et cultivaient la terre, les hommes chassaient. Les colons blancs ont mis fin à leur société matriarcale et matrilinéaire, renvoyé les femmes des champs à la cuisine.
« L’âme de mon père était d’une autre époque. D’une époque où le pays était peuplé de tribus qui écoutaient la terre et qui la respectaient. Lui-même s’est tellement imprégné de ce respect qu’il est devenu le plus grand homme que j’aie connu. » Cette omniprésence du monde vivant – animal, végétal, minéral – autour des personnages, mêlée à tout ce qui leur arrive, donne au roman une atmosphère originale, voire magique.
En épigraphe, une citation tirée de la Bible donne sa tonalité à chaque chapitre. La romancière a magnifiquement doté les enfants Carpenter d’une aura particulière. Betty, la narratrice, a une relation privilégiée avec son père. Ses frères et sœurs le savent, sans rien perdre pour autant de l’amour paternel qui les porte du début jusqu’à la fin. Et c’est lui qui les soutient, quelles que soient les circonstances. La mère de Betty a eu trop à porter elle-même pour venir en aide à ses enfants, même si elle s’y efforce.
Tiffany McDaniel, la fille de Betty, a mis dix-sept ans à écrire cette histoire de sa famille sur plusieurs générations, qui se déroule dans le sud de l’Ohio où sa mère a grandi, dans les contreforts des Appalaches. Contrairement aux habitants de leur petite ville où ils se heurtent au racisme ordinaire, les Carpenter ne craignent pas trop la malédiction attachée à la maison délabrée où ils ont emménagé. Le père a suffisamment d’histoires à leur raconter pour que la famille y vive avec ses propres mythes.
Le plus étonnant pour moi, à la lecture de Betty, best-seller abondamment primé où la question du destin des femmes est si présente, c’est qu’à travers une telle succession de souffrances en tous genres, cette romancière américaine née en 1985 parvienne à faire triompher deux thèmes très forts, ici inséparables : le bonheur de cohabiter avec la nature, l’initiation à la bonté.